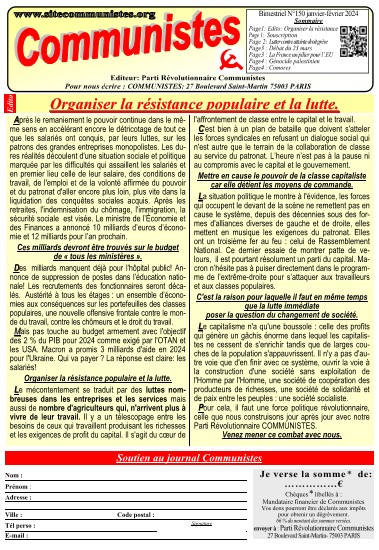L’entreprise, son organisation et sa gestion, son rôle économique et social sont au centre de beaucoup de déclarations et d’articles. Face à la perte de substance de l’industrie manufacturière en France, à un ample processus d’externalisation des productions, aux manques mis en lumière par l’épidémie de Covid 19 du fait des abandons de production sur le territoire national et à la crise profonde de l’emploi qui se dessine sur fond d’un chômage déjà élevé, de nombreuses voix préconisent des remèdes qu’ils jugent efficaces et suffisants pour résoudre la crise.
Ainsi, les mots et expressions de « nationalisation », « socialisation », « pole public », « communs », « réquisitions », « relocalisations », « partage des richesses »...fleurissent dans le langage politique et social. Que signifient-ils au juste ?
Au départ de toute analyse concernant l’entreprise, il convient de rappeler que dans le système capitaliste elle est non seulement le lieu concret de la production, mais aussi celui de l’exploitation du travail salarié, source du profit capitaliste qui se réalise dans les échanges marchands. C’est là que s’affrontent les intérêts inconciliables du capital et du travail : En bref, celui de la lutte des classes.
Depuis le développement du capitalisme et du mouvement ouvrier révolutionnaire au XIXe siècle jusqu’à nos jours, la question de la propriété sociale de l’entreprise est au cœur d’affrontements de classe entre les détenteurs du capital et ceux, les salariés, qui doivent vendre leur force de travail. Le capitalisme pour se développer a eu et a besoin d’un État qui favorise et régule la reproduction et l’accumulation du capital. Pour ce faire, l’État a utilisé et utilise la contrainte et la force face aux classes travailleuses, il développe et utilise sa puissance militaire pour affirmer les intérêts impérialistes et il peut, lorsque cela est nécessaire pour remplir ses fonctions, prendre la maîtrise voire le monopole de certains segments de la production et des services. Cette action de l’État est au service entier des intérêts du capital monopoliste aujourd’hui largement mondialisé.
Pour l’essentiel, les nationalisations modernes commencent avec la crise de 1930, qui voit se constituer un service public et quelques nationalisations d’entreprises. En France par exemple les industries d’armement sont nationalisées en 1936 ainsi que la Banque de France. La SNCF est créée en 1937. Ces nationalisations répondent à des exigences de sécurité (l’armement), de maîtrise de la monnaie et du crédit et de renflouement d’entreprises vitales comme le transport ferroviaire. C’est à la libération en 1945 que le concept de nationalisation prend en France un sens nettement plus politique. Il s’agit, dans un rapport de force national et international favorable à la classe ouvrière, d’imprimer dans la ligne du programme du Conseil National de la Résistance (CNR) une orientation progressiste voire anti-capitaliste.
Ainsi, était inscrit dans les principes prévalant pour les nationalisations l’idée de monopole public non soumis à la concurrence capitaliste et d'une gestion tripartite -État, syndicats, usagers- des entreprises et secteurs nationalisés. Dans la vision populaire des nationalisations ce qui reste très fort aujourd’hui ce sont les services publics. Notons que les anciens actionnaires furent indemnisés et que par exemple à EDF, ils continuent à toucher des dividendes non négligeables ! La mise en application du programme du CNR montre que les nationalisations ne sont pas seulement un acte administratif et économique, elles ont un contenu lié au rapport de force entre le capital et le travail. Ce que montre l’expérience historique, c’est que les nationalisations dans le contexte de la domination économique et politique du capital, sont remises en cause ou changent de sens dès que le rapport des forces se modifie en faveur du capital. Il en est ainsi parce que pour ce dernier il est vital de maîtriser la propriété des moyens de productions et d’échanges.
Ainsi, en 1982 avec un gouvernement d’Union de la Gauche (PS, PCF, Radicaux de Gauche) des nationalisations ont eu lieu, en particulier dans les secteurs de la chimie, du verre, de la métallurgie...et du secteur bancaire. Ces nationalisations qui n’ont concerné que les maisons-mères ont exclu une grande partie des entreprises concernées. Cette question du contenu des nationalisations fut l’objet d’un intense débat avant l’élection présidentielle de 1981, de plus les actionnaires furent largement indemnisés. Ces nationalisations, dont les salariés ont été tenus à l’écart, ont permis de profondes restructurations en particulier dans la chimie et la métallurgie. Une fois renflouées et restructurées ces entreprises ont été à nouveau privatisées à partir de 1986. Ces privatisations se plaçaient dans la continuation de la transformation du capitalisme français vers des multinationales capables de s’inscrire dans la compétition capitaliste mondiale. Le processus de privatisation ne s’est pas arrêté. Il continue et touche de plus en plus de grands services publics comme la Poste, la SNCF, la RATP, EDF, la santé publique et l’hôpital...
Aujourd’hui, le mot « nationalisation » est aussi utilisé pour désigner une opération de reprise (souvent partielle) avec une augmentation du capital par l’État afin de permettre une recapitalisation de monopoles en difficultés. Cela a été le cas par exemple avec Peugeot SA en 2014. Lorsque l’entreprise a terminé ses restructurations, le plus souvent défavorables à l’emploi, l’État se désengage à nouveau laissant aux actionnaires le bénéfice de l’opération. C’est la socialisation des pertes et la privatisation des profits ! Le gouvernement des USA a pratiqué de telles nationalisations récemment dans l’industrie automobile. Le ministre Lemaire, n’exclut d’ailleurs pas une telle démarche pour des sociétés comme Air France et Renault à condition bien entendu que leur compétitivité capitaliste, basée sur l’augmentation de la productivité (plus de valeur créé pour moins d’emploi, autrement dit des licenciements, et donc plus d’exploitation du travail) leur permettent de participer à la concurrence féroce que se livrent les monopoles à l’échelle planétaire. Rappelons que l’État détient des portefeuilles d’actions dans de nombreuses entreprises ce qui lui permet d’intervenir comme arbitre et régulateur dans les opérations de restructurations bancaires et industrielles. De telles « nationalisations » sont donc des outils des États impérialistes pour asseoir leur domination.
Dans un registre voisin, vient en force dans le discours public l’idée de « relocalisations ». On peut se reporter à l’article paru dans Communistes Hebdo N°664: delocalisations-relocalisations-mais-de-quoi-parle-t-on?
Les laudateurs de ces « relocalisations » se gardent bien d’analyser leurs causes profondes : la loi du profit et de l’accumulation capitaliste. Ils ne posent donc pas la question centrale qui est celle du rôle et de la responsabilité du capitalisme dans la situation nationale et internationale et à partir de là, la nécessité de le combattre, et de mener la lutte pour la prise du pouvoir politique par la classe ouvrière et les salariés exploités pour une société précisément sans exploitation de l’Homme par l’Homme.
Si le mot relocalisation (le miroir de la délocalisation) revient avec tellement de force, c’est qu’il y a le sentiment qu’un lien existe entre le chômage de masse et la désindustrialisation du pays. Pourtant, les causes et les responsabilités profondes des délocalisations restent bien ensevelies dans le discours dominant. Et pour cause ! Les délocalisations de la production sont une stratégie pour rétablir voire augmenter autant que faire se peut les taux de profits générés par la mise en mouvement du capital. Pour cela, il doit impérativement accroître l’exploitation du travail salarié. Il peut le faire de trois façons :
1. en allongeant la durée du temps de travail
2. en augmentant la productivité
3. en réduisant les salaires au maximum, autrement dit en surexploitant sans limites les salariés
C’est cette dernière variable qui pour l’essentiel guide le choix de localisation de la production ( par ex. Peugeot et Renault ont décidé de délocaliser en Turquie et au Maroc). Elle s’appuie sur la disparité à l’échelle internationale des taux d’exploitation de la main-d’œuvre. La mise en œuvre se fait aussi par la voie de la sous-traitance à l’intérieur des pays impérialistes mais aussi dans les pays sous-développés ou en voie de développement. Dans les pays développés, les entreprises sous-traitantes et leurs salariés sont à la merci des décisions des grands monopoles donneurs d’ordre. Dans les pays à bas salaires, les salariés surexploités sont dépendants du patronat « sous-traitant » de ces pays. Pour imposer cette exploitation, ces patrons organisent une répression sans limite, les organisations syndicales de classe sont l’objet de la part des États comme des patrons locaux d’une impitoyable mise hors la loi. La protection sociale est quasi-inexistante et le droit du travail réduit à sa plus simple expression. Les questions environnementales sont hors-la-loi et les assassinats de dirigeants syndicaux sont monnaie courante. C’est dans ces conditions que le capital des puissances impérialistes de premier rang est valorisé et qu’une partie importante de celui-ci entretient la spéculation financière. Car il n’y a qu’un capital celui dont la mise en mouvement dans la production produit de la plus-value, fruit de l’exploitation du travail salarié.
On trouve parfois utilisées des notions comme « socialisation ». Actuellement, le travail de production et d’échange est très socialisé dans les grandes entreprises monopolistes, mais la propriété de ces entreprises reste, elle, privée et entre les mains des actionnaires. Ce sont eux qui décident, avec les dirigeants des entreprises, des emplois, des salaires, des investissements, des types de production....Ils décident selon la logique capitaliste, c’est à dire celle du profit maximum pour les actionnaires. Nous le constatons aujourd’hui, par exemple, avec Sanofi qui en pleine pandémie décide de verser 4 milliards d’Euros à ses actionnaires. La notion de socialisation doit donc être précisée : socialisation des grands moyens de production et d’échange par l’expropriation des capitalistes. Quant à la « réquisition », elle peut concrétiser dans une phase aiguë de la lutte des classes l’utilisation d’un outil pour imposer des productions vitales pour la société.
Une autre tendance se dessine dans les discours et tout particulièrement ceux de la gauche socialiste (PS), communiste (PCF) et chez les écologistes (EELV) celle de mettre en avant ce qu’ils appellent : le « partage des richesses ». Il s’agit d’un leurre ! L’histoire nous l’apprend et nous le constatons tous les jours, la récente réforme de l’indemnisation du chômage le démontre une nouvelle fois – que le patronat ne lâche sur les revendications des salariés que lorsqu’il y est contraint par des luttes puissantes comme en 36, 45 et 68. Le patronat ne partage pas car son objectif fondamental c’est d’accroître les profits capitalistes. S’il garde le pouvoir dans l’entreprise et dans le pays, les conquêtes sociales sont rapidement remises en cause. Rien n’est donc acquis sans l’expropriation des capitalistes.
Les partis de gauche parlent aussi souvent de « communs ». Ils entendent par cela des sortes de monopoles naturels qui devraient être sous le contrôle public, par exemple : l’énergie, l’eau, les transports, la santé. On trouve mêlé à ce concept de « communs », qu’utilisent par ailleurs des économistes bourgeois comme J. Tirole, la notion de « pole public ». Cette dernière expression, complémentaire à celle de « communs », associe le secteur public au privé dont on sait par expérience qu’il organise le transfert de valeur du pole public au pole privé. Ne nous y trompons pas ! Cette notion s’oppose à celle de service public non soumis à la concurrence et répondant aux besoins de la population. Il ne s’agit évidemment pas de jouer sur les mots ou d’instruire des querelles linguistiques mais force est de constater qu’en isolant ces questions des objectifs de la société toute entière, c’est à dire en ne s’attaquant pas au capitalisme comme système d’exploitation et de domination, les défenseurs de ces thèses se placent sur le terrain de l’aménagement du capitalisme. De même, que ceux qui semblent confondre « service public » et « mission de service public ». Ils ne se préoccupent pas de qui détient le pouvoir économique et politique. Le capitalisme s’y adapte, il n’y qu’à voir son aptitude à intégrer les notions « d’économie verte ». Cette voie réformiste a montré ses limites et ses échecs et conduit, au plan politique et social, à une impasse.
Pour sa part , notre Parti Révolutionnaire Communistes s’emploie à démontrer que la racine des problèmes se trouve dans le capitaliste lui-même à un stade impérialiste ou les affrontements au sein de ce système pour la conquête des ressources, l’exploitation et la surexploitation de la force de travail, le contrôle des voies et des moyens de communications sont l’objet d’un affrontement d’une violence jamais atteinte. Nous résumons notre démarche par : « abattre le capitalisme et construire le socialisme » car nous signifions que sans la lutte des classes pour la conquête du pouvoir, sans l’expropriation du capital, il ne peut y avoir d’avancées significatives pour un nouvel ordre social, national et international. Aujourd’hui dans la réalité ce sont de puissantes multinationales qui dirigent le pays. Les nationalisations, c’est à dire l’expropriation du capital exige un changement de société par et pour la classe ouvrière et les travailleurs salariés. Cette lutte exige la force d’un parti révolutionnaire d’avant-garde !